Cannibalismes Spéculatifs
Pour un Post-Spécisme Écocentrique
par Ā
Les lignes qui suivent sont une cynique provocation à l’introspection, pour pænser*[1] notre rapport au monde via le tabou du cannibalisme ; elles sont une invitation, non sans être gênante, à la reconception des catégories d’humain·e·s et non-humain·e·s, de sujet et objet, de culture et nature, de sacré et profane ; et ceci par le prisme de la consommation alimentaire de ce que nous considérons être nos semblables : les cannibalismes mobilisés comme métaphore des cycles de notre monde. Explorons les obscures profondeurs de nos éthiques pour y trouver les fondations de nos ontologies*.
Pilier de l’anthropocentrisme occidental contemporain et clef de voûte du capitalocène*, la dichotomie sujet/objet a érigé les humain·e·s en être vivant·e·s doté·e·s d’une intériorité unique, pouvant de ce fait, s’approprier, exploiter, et accumuler les non-humain·e·s considéré·e·s comme de simples ressources.
Le « naturalisme » (DESCOLA, 2005), en tant qu’ontologie occidentale contemporaine, est une des manières de définir les frontières entre soi et autrui en se basant sur les dualismes culture/nature et sujet/objet qui déterminent ainsi les différences entre humain·e·s/non-humain·e·s. Par cette ontologie, les humain·e·s posséderaient une intériorité et un psychisme (une réflexivité, une conscience, une « âme », etc.) supérieurs aux non-humain·e·s, ce qui conférerait à ces derniers des droits et des considérations morales moindres, voire inexistants.
En occident, face à certaines dérives du naturalisme, une ontologie hybride a vu le jour : l’antispécisme* du véganisme et de l’animalisme. Certain·e·s des anima·ux·les[2] non-humain·e·s y sont considéré·e·s comme ayant une intériorité identique aux humain·e·s, ainsi l’exploitation des premiers par ces derniers devient immorale. Cette ontologie hybride, bien que bousculant les dualismes occidentaux, reste ancrée en tous points dans la dichotomie sujet/objet. Les anima·ux·les non-humain·e·s y sont considéré·e·s comme sujets, mais les autres non-humain·e·s (végétaux, montagnes, rivières, sols et autres) de notre monde restent objets, et donc ressources exploitables.
Envisageons alors des postspécismes* cannibales où les humain·e·s ne seraient non pas réifié·e·s en simple objet « viande », ce qui serait une vision ethnocentrique* erronée du cannibalisme, mais où la consommation alimentaire de ce que nous considérons comme nos semblables viendrait annihiler le dualisme sujet/objet.
Via le cannibalisme, envisageons ensemble un postspécisme non pas zoocentrique*, centré sur l’égalité entre anima·ux·les humain·e·s et non-humain·e·s, mais écocentrique*, et donc centré sur les interactions entre humain·e·s et non-humain·e·s, anima·ux·les et non-anima·ux·les, vivant·e·s et non-vivant·e·s, visibles et invisibles.
Cette dérangeante proposition est aux antipodes de la démarche de l’écrivain Jonathan Swift, qui dans un pamphlet intitulé « Modeste proposition sur les enfants pauvres d’Irlande » (SWIFT, 1729), proposa des nourrissons comme source d’alimentation pour réduire la misère de l’Irlande du XVIIIe siècle. Cette inconvenante suggestion est aussi bien différente de l’approche du controversé scientifique Magnus Söderlund, proposant la consommation de viande humaine comme solution pour atténuer le réchauffement climatique. Car nos conclusions sont non-matlhusianistes** : La « surpopulation » n’est pas le problème ! Mangeons plutôt les riches pour sortir du capitalocène.
Nous, nous ne mobiliserons pas le cannibalisme seulement pour son aspect transgressif et provocant, bien que cette virulence soit un atout pour une profonde remise en question de notre place dans le monde. Ce concept est aussi une catégorie bonne à pænser, mettant à vif nos dualismes naturalistes, fondements de nos manières d’être au monde. C’est un fait social total, « mettant en branle dans certains cas la totalité de la société et de ses institutions » (MAUSS, 1924), il « ne peut être isolé, il relève de l’ensemble des représentations qu’une société se fait d’elle-même et d’autrui » (KILANI, 2006). Parfait sujet de récits spéculatifs*, ce paroxysme de l’altérité, symbole de l’inhumain·e et fantasme de l’Autre, permet par reflet de nous contempler nous-mêmes. Le cannibalisme est une anthropopoiésis*.
Capitalocène et anthropocentrisme naturaliste
« Le fleuve Rio Doce, que nous, les Krenak, appelons Watu, notre grand-père, est une personne, et non une ressource, comme disent les économistes. Ce n’est pas quelque chose que quelqu’un puisse s’approprier ; c’est une partie de notre collectif » [3]
La « nature » est une construction sociale, qui se définit en opposition à la « culture ». Ce grand partage* est en interaction itérative avec l’extraction des humain·e·s occidenta·ux·les modernes de leur environnement, en tant que système (écosystèmes) et cycle (trophique*) ; pour ensuite diffuser de manière impérialiste cette vision du monde, du Soi et de l’Autre, par la colonisation, puis par la globalisation et les politiques de développement. « Comment un mythe fondateur peut-il être crédible s’il est fantasmatique ? L’hypothèse est que pour faire de cette impossible auto-extraction des réseaux trophiques un mythe auto-réalisateur, à un certain moment de l’histoire, l’humain occidental a élaboré une cosmologie et un tabou qui postulent un rapport diodique* au réseau trophique : nous pouvons nous nourrir du soleil emprisonné dans les vivants, mais les autres vivants n’ont pas le droit de se nourrir du soleil emprisonné en nous » (MORIZOT, 2016). Ériger notre ontologie naturaliste comme cause principale du capitalocène, serait étiologiquement* trop simpliste, mais pas sans fondement, bien au contraire. L’opposition entre les humain·e·s comme sujet·te·s muni·e·s d’une intériorité considérée comme si particulière, et le reste du vivant et du non-vivant, envisagé comme objet dépourvu d’âme, de conscience et de réflexivité, est caractéristique de cette ontologie. Pour les peuples non-naturalistes comme les animistes, les non-humain·e·s peuvent avoir une intériorité semblable à la nôtre. De ce fait, elles ne sont pas considérées comme des ressources mais comme des semblables, des membres de leurs collectifs, rendant ainsi inexistants les concepts de propriété privée et de dichotomie nature/culture. Pour les occidentaux ontologiquement naturalistes, il est donc possible de s’approprier ces non-humain·e·s (vivant·e·s et non-vivant·e·s), érigeant ainsi les humain·e·s-sujet·te·s comme despotes de la nature-objet. La propriété privée des « sujets » sur les « objets » est l’un des piliers du capitalisme, principale source de changement dans notre monde, surpassant les forces géophysiques. Détruisons alors les verrouillages socio-techniques et cognitifs autour de cette dichotomie structurant le capitalocène.
Antispécisme animaliste et zoocentrisme
Face aux dérives du naturalisme émergent certaines ontologies hybrides dont celles des antispécistes. Pour elleux, les anima·ux·les non-humain·e·s sont doté·e·s d’une intériorité semblable à la nôtre, et ne doivent donc plus être traité·e·s comme des ressources. Fondée sur des avancées éthologiques, cette éthique zoocentrée est une recherche d’horizontalité et d’égalité parmi les anima·ux·les, humain·e·s et non-humain·e·s. Bien que l’antispécisme soit pour les occidentaux[4] une manière de tisser des liens interspécifiques éthiquement plus sensibles et empathiques, et plus ou moins efficients écologiquement, cette ontologie hybride ne peut être un levier efficace face au capitalocène. En s’attaquant à l’anthropocentrisme utilitariste*, l’antispécisme animaliste, en plus d’être zoocentré, cherche à combattre l’humain·e « despote », en s’érigeant comme humain·e·s « gardien·ne·s ». « Il est un système d’interprétation définitive du monde dans lequel l’homme doit être le berger de la Terre et doit veiller de fait sur toutes ses ouailles animales et humaines » (CELKA, 2012). L’humain·e gardien·ne, protégeant ses semblables anima·ux·les des autres humain·e·s despotes, reste une position dominante dans la pyramide anthropocentrique du vivant. Despote, gestionnaire, ou gardien, sont des postures de relation verticale avec le reste du monde.
Bien que la position de cet écrit reste critique envers l’ontologie antispéciste, nous apportons notre soutien aux activistes antispécistes dénonçant les dérives du productivisme. Bien que l’agribashing* exercé (avec plus ou moins de violence) sur le monde agricole est préjudiciable aux humain·e·s agricult·eur·ice·s, elleux-mêmes victimes du système productiviste, et particulièrement de la PAC* en Europe, nous nous positionnons contre les répressions face aux mouvements antispécistes. FUCK LA CELLULE DEMETER* ! Et au passage, FUCK LA PAC !
Spécisme, antispécisme et postspécisme
Le spécisme dans sa définition actuelle fortement zoocentrée, est une éthique où « l’espèce à laquelle un animal appartient, par exemple l’espèce humaine, est un critère pertinent pour établir les droits qu’on doit lui accorder. […] Par extension, le spécisme renvoie aussi à l’idée que les humains accorderaient une considération morale plus ou moins importante aux individus des autres espèces animales en fonction de celle-ci : les anima·ux·les de compagnie verraient par exemple leurs intérêts davantage pris en compte que les anima·ux·les d’élevage, ceux destinés à l’expérimentation ou considérés comme nuisibles »[5]
L’antispécisme est une notion construite en opposition au spécisme. Pourtant, se définir en négatif de l’ennemi peut fermer des horizons et nous épuiser en chemin. « S’opposer à quelque chose, c’est contribuer à son maintien. […] Il faut aller ailleurs, avoir un autre but ; alors on marche sur une autre route. » (LE GUIN, 2006)
L’antispécisme est une tendance à l’intégration des anima·ux·les non-humain·e·s dans la catégorie « Culture », réitérant le grand partage. Il est alors crucial de pænser avec un postspécisme réintégrant l’humain·e et sa « Culture » dans la « Nature », en annihilant le grand partage.
Donna Haraway nous met en garde contre le préfixe « post- », tel une promesse impliquant une ère en plus, sans l’épaisseur du passé, nous déresponsabilisant du présent et de ses ruines. Nous ne vivons effectivement pas dans le « post- », pourtant cette particule aux aspects périlleux a pour avantage de nous informer sur ce que notre notion cherche à dépasser, sur ce qu’elle n’est pas, sans toutefois nous imposer l’essence stricte d’une définition ni contredire une notion « ennemie ». Notre affixe semble être adapté à la fabrication de concepts spéculatifs, en congruence avec la conscience et le souhait de créer de nouveaux récits pour de nouveaux mondes. Le postspécisme est encore plus qu’un au-delà la hiérarchisation anthropocentrique des vivant·e·s, c’est une proposition de dépassement de la notion d’espèce, et ceci sans chercher à nous enfermer dans un nouveau -isme. Bien au contraire, ce concept est ouvert à une multitude de chemins, offrant de nouvelles manières de tisser des relations, sans aucun horizon fixe comme solution mise à part une vision holistique* du monde.
Postspécisme écocentrique
«
– " Elle parle avec sa soeur ",
– " Mais c’est une pierre " rétorqua le chercheur.
Et le camarade dit : " En effet, et où est le problème ? "[…] Tout comme cette femme hopi qui parlait avec sa sœur pierre, on trouve, dans de très nombreuses régions du monde, un grand nombre de personnes qui parlent avec les montagnes. Dans les Andes, par exemple en Équateur ou en Colombie, on connaît des lieux où les montagnes forment des couples. Il y a la mère, le père, le fils, une famille de montagne qui partage des sentiments, et échange tout un tas de choses. Les gens qui vivent dans ces vallées font des fêtes pour ces montagnes, leur donnent de la nourriture, leur font des cadeaux et reçoivent eux-mêmes des cadeaux des montagnes. »[3:1]
Le postspécisme ici spéculé est donc une proposition de dépassement du zoocentrisme, et plus largement du biocentrisme, via l’inclusion de certains non-vivant·e·s – les biotopes comme les rivières, les déserts, les montagnes, etc, ou les facteurs abiotiques** les composants, comme le climat, l’air ou les sols – dans nos considérations morales, et ceci via un égalitarisme écosphérique*. Tout comme le fleuve Watu, grand père de l’activiste Ailton Krenak, la sœur pierre de la femme hopie, ou les familles de montagnes de certains peuples andins, ces êtres abiotiques ne doivent plus être considéré·e·s comme des ressources ou de simples paysages, mais bien comme des semblables faisant partie du « Nous », pour ainsi tisser et repænser les complexes interactions de nos mondes.
Le postspécisme serait le fruit de recherches de désindividualisation* et d’écosystémisation* de la notion d’espèce, via la reconsidération de nos visions des « êtres » vivants.
Espèce : « une population ou un ensemble de populations dont les individus peuvent effectivement ou potentiellement se reproduire entre eux et engendrer une descendance viable et féconde » [6]
Individu[7] : 1. « Être formant une unité distincte (dans une classification) ».
- « Corps organisé vivant d’une existence propre et qui ne saurait être divisé sans être détruit (plante, animal…) ».
Pourtant ces individus qui constituent les populations, formant elles-mêmes les espèces, ne sont en rien « une unité distincte » « vivant d’une existence propre et qui ne saurait être divisée sans être détruite » ;
Car, nous ne sommes pas des individus mais des écosystèmes[8] ;
Nous ne sommes pas « une unité » mais des enchevêtrements de relations symbiotiques constitués d’innombrables micro-organismes[9] ;
Nous ne sommes pas « distincts », autonomes et étanches dans un environnement qui se contenterait de nous entourer ; (INGOLD, 2007)
Nous sommes l’environnement ;
Nous sommes le paysage ;
Nous sommes le monde ;
Nous sommes tou·te·s du lichen (GILBERT, 2012. HARAWAY, 2020. POTOT, 2014) ;
Nous sommes un ensemble d’enchevêtrements fait d’échanges constants entre nos écosystèmes supposés « internes » et les écosystèmes supposés « externes », et d’interdépendances entre des vivant·e·s et non-vivant·e·s.
« Car “ nous ” ne désigne pas une addition de sujets (“ je ” plus “ je ” plus “ je ”…) mais un sujet collectif, dilaté autour de moi qui parle : moi et du non-moi, en partie indéfini, potentiellement illimité, moi et tout ce à quoi je peux ou veux bien me relier. Benveniste le disait, et c’était une surprise : “ nous ” n’est pas le pluriel de “ je ”, un pluriel dénombrable découpé dans le plus grand ensemble de “ tous ”. Non, ce n’est pas comme ça que le pronom se construit. “ Nous ” est le résultat d’un “ je ” qui s’est ouvert (ouvert à ce qu’il n’est pas), qui s’est dilaté, déposé au-dehors, élargi » (MACE, 2019).
Pour un « nous » tellement élargi, que tout corps nourri devienne cannibale, se substantant d’un semblable non-humain·e ;
Pour un postspécisme, non pas centré sur l’égalité entre les êtres vivant·e·s, mais sur ces interactions constantes qui constituent notre monde, sur ces complexes tissages faits d’abiotique et de biotique* ;
Pour un postspécisme ɴon-ᴀ*[10] ;
Pour un postspécisme écocentrique, où les humain·e·s ne seraient pas despotes, gardien·ne·s, ou gestionnaires, ni même vivant·e·s parmi les vivant·e·s, mais écosystèmes parmi les écosystèmes. Nous faisons parti de ce Tout, ou plutôt « chaque chose est connectée à quelque chose, qui est connecté à autre chose […] La spécificité et la proximité des connections importent - avec qui nous sommes-nous liées et comment » (VAN DOOREN, 2016).
| Vision « espèce » | Rôle « humain » | |
|---|---|---|
| Spécisme | Anthropocentrisme (naturaliste) | Despote |
| Antispécisme | Zoocentrisme | Gardien·ne |
| Postspécisme | Écocentrisme | Écosystème parmi les écosystèmes |
Action et cognition
Les enjeux qui constituent ce postspécisme écocentrique ont déjà été pensés par des anthropologues et philosophes contemporains. Toutefois ces idées à elles seules ne peuvent suffire à enclencher des changements de paradigmes. La cognition sans action ne peut engendrer de réelles modifications de notre réalité, car il suffirait alors de déconstruire le concept de « Nature » pour désamorcer le grand partage et le capitalocène ; inversement l’action dépend de la cognition dans un éternel dialogue interactif. Nous sommes effectivement attablés autour de ce texte, et non autour d’un festin anthropophage, mais ne nous embourbons pas dans un primat cartésien (de la cognition sur l’action), et proposons alors des actions en lien avec notre postspécisme.
Certaines de ces actions existent déjà, comme ces personnalités juridiques qui ont été accordées aux fleuves Whanganui, Gane et Yamuna (DAVID, 2017). Ces actes juridiques, malgré leurs noms et bien qu’accompagnés d’actions symboliques, peuvent paraître du ressort de la cognition, mais sont dans nos sociétés l’exemple type du discours performatif*, et peuvent donc être considérés comme des actions. Grâce à la prise en compte des ontologies et des spiritualités autochtones, ces fleuves sont devenus des sujets de droits. Selon Descola, attribuer des personnalités juridiques aux écosystèmes « peut avoir des conséquences très intéressantes en ce sens qu’il se démarque complètement du modèle du capitalisme industriel » (GAMEIRO, 2020). Pourtant, à l’instar des souhaits antispécistes liés à l’attribution de personnalités juridiques à des anima·ux·les non-humain·e·s, cela revient à élargir l’individualisme moderne du capitalisme aux non-humain·e·s. De plus, cette intégration des fleuves dans la « Culture » via une personnalité juridique, a pour le moment très peu d’effets positifs concrets. En attendant l’adoption de traités ecosphériquement plus égalitaires et globaux[11], envisageons d’autres pratiques.
Via le grand partage, l’humain·e s’est extrait·e cognitivement de son monde, mais aussi physiquement des réseaux trophiques. Les humain·e·s occidentaux passent leurs vies à extraire l’énergie du soleil accumulée dans ces réseaux[12], sans jamais la rendre. « Nous pouvons êre mangeurs, mais pas mangé. Mangeur non mangeable » (MORIZOT, 2016). Pour une écosystémisation des humain·e·s, il est alors crucial de les repositionner dans la chaîne alimentaire. En analysant son niveau trophique (indice 2.2, proche de l’anchois ou du cochon), des chercheur·euse·s ont constaté·e·s que l’humain·e n’est pas le superprédateur que l’on pense (BONHOMMEAU, 2013). Il s’agirait alors de raviver les populations de grands prédateurs, pour réaffirmer le statut de proie de l’humain·e[13].
Pour sortir de cette relation trophique univoque, et à défaut de grand prédateur (et de grand charognard), le compost humain·e semble être une pratique prometteuse et plus réalisable à l’heure de la 6ème extinction de masse. Cette pratique semble des plus efficaces pour une écostystémisation de certain·e·s humain·e·s, car « la culture de la supréatie humaine propre à̀l’Occident se caractéise par un trè grand effort pour nier que nous, humains, sommes aussi des animaux placé dans la chaîe alimentaire. Cette néation, du fait que nous sommes de la nourriture pour d’autres, est visible dans nos pratiques mortuaires et funéaires. Le cercueil solide que l’on enterre, comme le veut la convention, bien en dessous du niveau d’activitéde la faune du sol, et la dalle au-dessus de la tombe pour empêher quiconque de nous déerrer, permettent d’empêher le corps humain occidental de devenir de la nourriture pour d’autres espèes » (MORIZOT, 2016). Com-posthumain·e.
Viande
« Le tabou consiste donc à interdire et à minimiser toutes les conditions par lesquelles nous serions de la biomasse à disposition des autres. […] Le tabou est nécessaire pour rendre ce mythe de l’auto-extraction crédible : pour que l’expérience réelle coïncide avec la fiction, pour que la fiction devienne vraie de n’être pas démentie par les faits. Les événements où l’humain est alors “ rabaissé ” au statut de viande constituent une transgression fondatrice, qui appelle réparation, pour rétablir un ordre du monde »[14]
« Les corps nourris se nouent à la chair du monde, y reflètent les centres virtuels de leurs tensions, redoublant ainsi les perspectives et l’ampleur des questions suscitées par la prise alimentaire. » [15]
La « viande » est, tant pour l’antispécisme végan que pour les pratiques cannibales, lié à nos conceptions du Soi et de l’Autre, de l’Objet du Sujet.
Cet obsujet*, élément charnière des réseaux trophiques, est de la mort qui donne vie. « Dans d’autres cultures, le fait d’êre mangéne délenche pas les mêes psychoses. Dans la cosmologie du chamanisme sibéien (…), l’ordre du monde est vu comme une circulation de la chair » (MORIZOT, 2016). Redevenir « viande » ne serait-il pas une innovation de rupture radicalement plus efficace que de sortir de nos habitudes carnistes occidentales ? Redevenir « viande » ne permettrait-il pas aux carnistes de repasser de la « sarcophagie » à la « zoophagie »[16] (VIALLES, 1988) ? Redevenir « viande » ne serait t-il pas le moyen de passer d’un spécisme anthropocentrique ou d’un antispécisme zoocentrique, à un postspécisme écocentrique ? Redevenir « viande » n’annihilerait-il pas « métaphysiquement notre extraction au-dessus de la communautébiotique » (MORIZOT, 2016) ?
Étant donné l’état actuel des populations de grands prédateurs, le cannibalisme semble une des solutions les plus simples et directes pour un retour de l’humain·e dans son statut de « biomasse à disposition des autres », en rendant l’énergie et la matière accumulée tout au long de nos vie sans l’emporter dans la tombe. Ce cannibalisme doit être obligatoirement couplé d’une pratique de compostage humain pour ne pas retomber dans une relation diodique de circulation de l’énergie. Com-postspécisme.
Cannibalisme
« Avant d’être un acte d’ingestion de la chair humaine, le cannibalisme reflète une logique sociale »[17]
Si notre postspécisme écocentrique—résultant d’une recherche d’écosystémisation de l’humain·e dans « sa condition de biomasse partageable par d’autres » (MORIZOT, 2020)—se concrétise spéculativement, non pas seulement dans le compostage humain, mais dans le cannibalisme, c’est que ce dernier est un puissant pied de biche cognitif pour des changements de paradigmes*.
Le cannibale, « reposant sur le présupposé de l’altérité extrême, (…) épouse souvent les traits du monstre ou du diable. Sauvage intégral, radicalement autre, le cannibale échappe à l’humanité » (KILANI, 2006). En occident, le cannibalisme en définissant l’inhumain·e, permet par reflet de définir l’humain·e. Inversement, dans les sociétés où le cannibalisme rituel est institutionnalisé, il permet de faire société et de faire humain·e, par « absorption du corps social par chacun, ou encore de l’absorption de chacun par la totalité du corps social » (FOUCAULT, 1999).
Les pratiques alimentaires (véganismes, carnismes, endocannibalismes, exocannibalismes) mettent en exergue les liens existants entre le fait de manger ou ne pas manger l’Autre ou le Nous, et nos manières de nous identifier et de nous différencier.
Pour l’endocannibalisme, qui est le fait de manger les siens, les membres de son groupe décédés généralement d’une mort naturelle, il s’agit de réaffirmer le statut de « semblable » du défunt, qui est souvent bouilli et mélangé à d’autres ingrédients, dans une cuisson élaborée et longue.
Inversement l’exocannibalisme est le fait de manger l’Autre. Un Autre proche, pas si différent, comme un « beau frère » pour s’exprimer dans une logique Tupi-guarani (KILANI, 2006). Cet ennemi mis à mort avec respect, préparé par une cuisson peu élaborée comme le rôtissage, permet de s’identifier dans la différence, à travers l’Autre.
Ces cannibalismes institutionnalisés ne réifient à aucun moment l’humain·e en « objet viande ». Le statut de sujet de l’individu·e mangé·e est renforcé par ces rituels, dans ces sociétés où les non-humain·e·s peuvent aussi être sujets.
Le cannibalisme est hautement ontologique. « Le cannibalisme, avant d’être une façon de manger, est une façon de penser les relations sociales » (KILANI, 2006). Nous mangeons les Autres vivant·e·s non-humain·e·s, mais nous manger nous même ne reviendrait-il pas à nous réintégrer parmi ces Autres vivant·e·s, et à épaissir ce « Nous » ?
Le cannibalisme, en replaçant l’humain·e dans « sa condition de biomasse partageable par d’autres », vient annihiler le mythe naturaliste de l’auto-extraction de la « Nature », et rétablit l’humain·e dans des interactions écosystémiques plus équitables. Nous faisons partie d’un tout, et nous sommes régis par les mêmes principes : nous sommes des écosystèmes conduits par des cycles. Parmi ces cycles régissant notre monde, ce sont les réseaux trophiques qui sont en jeu dans notre cannibalisme spéculatif.
Rituel, cycle et système
« Le rite et les rituels constituent le ciment des groupes humains ; ils donnent le cadre qui va permettre de marquer d’une façon stable les passages importants de la vie avec leur entrée et leur sortie. Ils vont manifester les racines du groupe et l’appartenance de chacun à ses racines. »[18]
« Ce qui différencie les païens de nous, c’est qu’à l’origine de toutes leurs croyances, il y a un terrible effort pour ne pas penser en hommes, pour garder le contact avec la création entière, c’est-à-dire avec la divinité. » [19]
Nos cannibalismes spéculatifs, comme tout cannibalisme social*, doivent être codifiés par des structures rituelles institutionnalisées. Le rituel, en plus de créer des égrégores*, a « pour fonction de donner des repères dans l’espace et dans le temps, il est un élément structurant de la vie, il rythme les saisons, les âges de la vie, il donne de la profondeur et de l’importance aux différents moments charnières de notre vie » (DUPIN, 2009). Plus que des repères, les rituels nous replacent dans les cycles et les systèmes ;
dans l’univers, le système solaire et les écosystèmes ;
dans les cycles cosmiques, saisons, et parcours de vie.
« L’humanitéoccidentale (…) s’est inventé comme une diode pour l’éergie cosmique : la seule espèe en qui la circulation de l’éergie, ou de la chair-soleil dans le cosmos vivant, ne va que dans un seul sens. » (MORIZOT, 2016).
Ritualisons et replaçons-nous dans les cycles et les systèmes !
βίος θάνατος βίος[20]
« Notre tâche est d’interpréter ce cycle Vie/Mort/Vie, de le vivre avec autant de grâce que possible, quitte à hurler comme des chiennes démentes lorsque c’est impossible »[21]
L’anthropologue Margaret Mead – « particulièrement intéressée par l’importance des rituels dans la construction de l’identité, comme apportant le contexte culturel indispensable à l’existence signifiante de l’homme » (DUPIN, 2009) – soulignait l’importance de recréer des rituels « laïques » pour « rassembler la communauté et renforcer le sentiment d’appartenance » (ibid.) à une culture ou, plus généralement, à l’espèce humaine. Les rituels spéculatifs pour des postspécismes écocentriques doivent rassembler une communautéplus large que « l’espèce humaine » dans un égalitarisme ecosphérique radical ; et ils ne doivent pas être laïques, ni sacralisés.
La dichotomie Sacré/Profane est issue d’une catégorisation occidentale. Pour enclencher des changements de paradigmes, sa déconstruction semble tout aussi pertinente que celle de notre Nature/Culture. « Le sacré est une notion d’anthropologie culturelle permettant à une société humaine de créer une séparation ou une opposition axiologique entre les différents éléments qui composent, définissent ou représentent son monde, (…) il s’oppose essentiellement au profane, mais aussi à l’utilitaire »[22]. Profane : Du latin profanus signifiant « devant le temple ».
Notre monde dans son entièreté ne devrait-il pas être temple ?
Le caractère « utilitaire » des composants de notre monde n’est-il pas la caractéristique d’une vision anthropocentrique nous ayant mené vers le capitalocène ?
N’est-il pas urgent de repænser nos manières de « séparer ou d’opposer axiologiquement les différents éléments qui composent, définissent ou représentent notre monde » ?
Si les chemins proposés s’expriment par le rituel, c’est que le cannibalisme social en est inséparable, mais c’est aussi que la magie, ou plus largement les spiritualités[23] apparaissent comme des disciplines nécessaires aux changements de paradigmes. Les sciences actuelles n’étant pas aptes à enclencher ces changements et à résoudre les problématiques du capitalocène[24], il est alors crucial de changer nos manières de faire levier. Cette reconsidération critique de la science et de la magie se fait ressentir dans certaines nouvelles pratiques militantes. La magie comme acte militant, et s’exprimant via le rituel, peut servir, entre autres[25], à replacer symboliquement et performativement l’humain·e dans les cycles et les systèmes. Si l’acte juridique est le discours performatif par excellence dans les sociétés occidentales, l’acte rituel l’est pour de nombreuses autres sociétés.
L’adoption de pratiques rituelles exotiques, ou la réadoption de pratiques anciennes par les occidentaux, ont peu de sens. Il nous faut alors créer de nouveaux rituels pour des nouveaux mondes.
Rituel néo-endocannibale spéculatif d’écosystémisation
L’endocannibalisme est un moyen d’introduire le défunt dans le cycle du vivant.
« En effet, le traitement qui est réservé au cadavre dans l’endocannibalisme indique la volonté de nier le processus de mort et de perpétuer le défunt dans le circuit vital. Le cannibalisme affirme une continuité entre la vie et la mort et entre les générations. Il concrétise en quelque sorte la dette payée aux ancêtres » (KILANI, 2006).
L’interprétation de l’endocannibalisme par certains anthropologues met l’accent sur la « négation du processus de mort », pour réintroduire « l’âme » « du défunt dans le circuit vital ». Mais cette introduction du mort dans le cycle du vivant n’est elle pas plutôt une affirmation du processus de mort ? Cette vision des anthropologues n’est-elle pas fortement marquée par une vision ethnocentré de la mort[26], comme rupture et non comme moment d’un cycle?
Dans le cadre d’un projet de design spéculatif sur l’alimentation du futur à l’ESAA de la Martinière Diderot, un scénario de rituel néo-endocannibale a été mis au point :
« 1- L’envol de l’âme »
Dans une première phase rituelle, le corps est placé dans un dispositif technologique, où des solution à basse température vibrent sous l’effet d’ultrasons pour séparer le corps, l’âme et les protéines du défunt.
« 2- Partage d’un repas »
Puis, un « repas funéraire » entre les membres de la famille débute avec l’ingestion des protéines du mort dans une infusion liquide, pour ainsi « faire vivre son âme à travers eux ».
« 3- Potager des âmes »
Les restes du défunt sont biodégradés dans « un lieu de verdure propice au recueillement » (PARISE, 2019).
Ce rituel spéculatif peut correspondre à une vision postspéciste et écocentrique du cannibalisme. La consommation du corps du défunt par des humain·e·s lors du repas funéraire, puis par des non-humains dans le potager des âmes sied parfaitement à une écosystémisation des humain·e·s. Car en l’absence de grands prédateurs replaçant les humain·e·s dans sa position de proie, il est crucial de coupler le cannibalisme rituel par une pratique de compostage humain, pour que la biomasse humaine ne soit pas partagée uniquement par une communauté d’humain·e·s. Il est nécessaire de souligner que le projet de « faire vivre son âme à travers eux », ne doit pas se limiter à un « eux » correspondant à la famille humaine du défunt, et s’élargir à un « nous » le plus épais possible, pour « faire vivre son âme à travers [le monde] ».
Le dispositif technologique d’extraction des protéines du défunt semble superflu, et peut être remplacé par des recettes plus low tech, inspirées par exemple des soupes de légumes et d’os brûlés des Yanomamis (KILANI, 2006). De plus, ces recettes de soupes nécessitent un compostage humain·e·s pré-repas cannibale pour pouvoir récupérer les os. Elles proposent ainsi le partage de la biomasse humaine d’abord aux êtres non-humain·e·s de la litière forestière, et non pas les restes d’un repas cannibale, ce qui semble être plus diplomatique et « cosmopoli » (MORIZOT, 2020), en s’inscrivant dans une recherche de « tact ontologique » (DESPRET, 2019).
Changements de paradigmes et récits spéculatifs
« Développons nos forces à pouvoir toujours raconter une histoire de plus, un autre récit. Si nous y parvenons, alors nous retardons la fin du monde. »[3:2]
Les récits spéculatifs sont performatifs, et peuvent être des prophéties auto-réalisatrices. Proposer un récit sur le futur influe sur celui-ci, qu’il soit prospectiviste ou fictionnel. Les dystopies de science fiction et les récits eschatologiques des collapsologues, du GIEC, ou des super-ordinateurs de la NASA, engendrent en réponse, des dispositifs de préparation à cette fin de notre monde. Ces dispositifs sont des récits spéculatifs auto-réalisateurs. Acheter un bunker et des armes, ou s’exiler dans une communautépour faire de la permaculture, sont deux dispositifs bien différents de préparation à la fin de notre monde, et auto-réalisent des futurs radicalement opposés. Le futur postcapitaliste ne sera évidemment pas une utopie reposant sur l’entraide et le retour à la « nature », ni une dystopie basé sur l’individualisme et la guerre pour l’appropriation des ruines industrielles, mais peut être une mosaïque d’hybridations de ces deux récits, une mosaïque de réponse face à la fin de notre monde. Pour que notre cannibalisme spéculatif ne s’inscrive pas seulement dans des récits trop utopistes, proposons d’autres chemins un peu plus belliqueux.
Rituel néo-exocannibale : Manger les riches
« Rousseau était peuple aussi, et il disait : Quand le peuple n’aura plus rien à manger, il mangera le riche »[27]
Le capitalisme , cet ennemi invisible, ce puissant sortilège entravant nos vies, insensible aux coups d’épée dans le vent, est conduit par des humain·e·s, avec des visages, des noms, et des adresses. Ces 1% qui possèdent la moitié des « richesses » du monde sont facilement identifiables, et il est crucial de les mettre face aux « enjeux méaphysiques de leur propre déoration » (MORIZOT, 2016). Ces humain·e·s se sont approprié·e·s nos partenaires non-humain·e·s, sans jamais partager et rendre l’énergie et la matière accaparée. Ielles pratiquent une forme de cannibalismes antisociale, perverse, et destructrice : Le capitalisme. Il semble alors logique que ces 1% soient la cible idéale pour un néo-exocannibalisme, un moyen symbolique fort pour qu’ielles rendent commun ce qu’ielles ont pris ; pour nous identifier et constituer un « nous », en nous différenciant d’eux, et en leur rappelant leur statut de proies intégrées dans le réseau trophique. Il n’est aucunement question de cautionner la peine de mort ou toute forme de lynchage populaire, cette proposition de néo-rituels sacrificiels visant les initiateurs des malheurs durables s’abattant sur nous, reste une cynique élucubration d’humour noir, bien qu’à vertu spéculative. En considération du triangle culinaire cannibale de Mondher Kilani, la recette qui convient pour préparer ces riches doit être basée sur la pratique du rôtissage ; cuit à feu vif dans des brasiers insurrectionnels, alimentés par les documents et mobiliers des banques et centres de pouvoir fraîchement saccagés. Ce rituel doit se faire à visage masqué, en habits intégralement noirs, sans signe distinctif, pour que les identités individuelles se fondent dans une identité collective. Le rôti se situant entre le cuit et le cru dans le triangle culinaire, les 1% rôtis se dégustent bleus, crus au cœur, car « ce qui est cuit nous ressemble et nous rassemble et ce qui est cru nous est différent et nous sépare » (KILANI, 2006). Il est important d’offrir plus de la moitié de ce festin à des êtres charognards et détritivores, en la déposant dans le fragment d’holocène* le plus proche, toujours pour ne pas retomber dans une relation diodique de circulation de l’énergie.
Holisme radical
L’holisme sous-tendant notre postspécisme écocentrique est fortement et ouvertement critiqué par les mouvements antispécistes. Ces derniers assument leur zoocentrisme via un réductionnisme* éthique. Jusqu’à ce présent chapitre, le concept « ontologie » a été mobilisé dans sa version anthropologique descolienne ; maintenant pour cette conclusion, glissons sémantiquement vers une « ontologie » dans son sens épistémologique, comme grand concept, qui nous sert à appréhender le monde de deux manières opposées : Le holisme et le réductionnisme. Selon le philosophe antispéciste Yves Bonnardel, par la vision holistique de l’écologie, les anima·ux·les non-humain·e·s « n’existent pas pour eux mêmes, à la recherche de leurs propres satisfactions, mais sont des instruments d’une fin qui les dépasse, qu’il s’agisse de la bonne marche des écosystèmes ou de la survie de leurs espèces. En fin de compte, ils sont au service du Tout, de la nature à laquelle ils sont censés appartenir. Ils en sont des parties et on ne leur reconnaît de valeur que relative, en fonction du rôle qu’ils sont censés y jouer » (BONNARDEL, 2020). Notre cannibalisme spéculatif pour un postspécisme écocentrique, propose l’abolition de la dichotomie objet/sujet, et une écosystémisation des humain·e·s aux côtés de leurs semblables vivant·e·s, anima·ux·les et non-anima·ux·les, non-vivant·e·s, visibles et invisibles. Pour qu’ainsi, ce « nous » épaissi au maximum, soit dans une forme d’égalitarisme ecosphérique extrême, « au service du Tout », comme « des instruments d’une fin qui nous dépasse », pour nous ancrer dans le « rôle que nous sommes censés y jouer », « n’existant pas pour nous mêmes », étant « nous » même le « Tout », tels des écosystèmes parmi les écosystèmes.
Arne NÆSS, le fondateur de l’écologie profonde, nous met en garde contre le « mysticisme de la nature » et la fusion dans le Grand Tout, qui serait une interprétation religieuse et une négation de nos individualités. L’humanisme « a glorifié l’âme humaine individuelle comme un objet ayant une valeur infinie et transcendantes, il a exalté l’individu comme le seul créateur et a répandu sur lui une partie des attributs divins » (BYRNE, 1987). L’humanisme comme religion a fait son temps, s’agirait-il alors de s’engager dans une écologie religieuse[28]. Catherine Larrère (dans Genèse par CALLICOTT) nous répond « Et pourquoi pas ? ».
Cette posture posthumaniste* est virulente, mais nécessaire pour cette élucubration spéculative à la fonction de pied-de-biche cognitif.
Des rituels cannibales spéculatifs pour un postspécisme écocentrique ;
Pour une désindividualisation et une écosystémisation des humain·e·s ;
Pour un égalitarisme écosphérique ;
Pour se replacer dans les cycles de notre monde ;
Pour une fin des grands partages ;
Pour une vision holistique de nos réalités ;
Pour un postspécisme ɴon-ᴀ,
non pas comme la description objective d’un « territoire »,
mais comme une « carte » pour des changements de paradigmes.
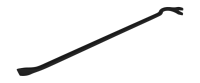
Lexique digestif pour cannibales spéculati·f·ve·s
Les concepts en italique ci-dessous sont des néologismes ɴon-ᴀ.
Abiotique
Relatif au monde non-vivant.
Agribashing
Critique du mode de production agricole intensif culpabilisant les agriculteur·ice·s, elleux-mêmes victimes de ce système.
Antispécisme
« [L]le spécisme est l’idéologie qui justifie et impose l’exploitation et l’utilisation des animaux par les humains de manières qui ne seraient pas acceptées si les victimes étaient humaines. » (OLIVIER, 1991). L’anti-spécisme est l’idéologie qui combat le spécisme.
Anthropocentrisme
L’humain·e comme centre du monde.
Anthropopoiésis
Fabrication symbolique de l’humain·e.
Biocentrisme
Les vivant·e·s comme centre du monde.
Écosphérique
Relatifs à l’ensemble des vivant·e·s et des non-vivant·e·s, visibles et invisibles, interagissant ensemble.
Biotique
Relatif au monde vivant.
Cannibalisme social
Cannibalisme institutionnalisé qui « fait société », contrairement au cannibalisme de survie, ou le cannibalisme criminel.
Capitalocène
Ensemble des événements géologiques et des malheurs durables, résultant non pas des activités humaines, mais des activités capitalistes. Alternative à anthropocène.
Cellule DÉMÉTER
« Cellule de la gendarmerie nationale française créée en 2019, qui a pour objectif de protéger les agricultrices et agriculteurs des agressions et intrusions sur les exploitations agricoles. Le dispositif est critiqué, tant par des agriculteurs que par des associations ».
https://fr.wikipedia.org/wiki/Cellule_Déméter
Conservationnisme
Nature protégée avec l’humain·e intégré·e dans des cercles vertueux. Radical : « Nous ne défendons pas la nature, nous sommes la nature qui se défend » - ou qui contre-attaque.
Désindividualisation
Sortir de la vision individualiste des « êtres ».
Réseau Diodique
« Dispositif de circulation de l’énergie (ce que nous sommes bien, dans les faits, aux sens métabolique et écologique) qui ne laisse passer l’énergie que dans un seul sens – ici du monde à lui, et pas de lui au reste du monde vivant » (MORIZOT, 2016)
Discours performatif
Signe linguistique réalisant ce qu’il énonce.
Écocentrisme
Les interactions entre tout les vivant·e·s et non-vivant·e·s comme centre du monde.
Écosystémisation
Rendre écosystémique la vision des « êtres ».
Égrégore
« Un esprit de groupe constitué par l’agrégation des intentions, des énergies et des désirs de plusieurs individus unis dans un but bien défini ».
https://fr.wikipedia.org/wiki/Égrégore
Ethnocentrisme
« Voir le monde et sa diversité à travers le prisme privilégié et plus ou moins exclusif des idées, des intérêts et des archétypes de notre communauté d’origine, sans regards critiques sur celle-ci » (TAGUIEFF, 2013). Par l’impérialisme des cultures occidentales, cette notion est ici synonyme “d’eurocentrisme” ». Les occidentaux comme centre du monde.
Étiologie
Étude des causes et des facteurs d’une maladie.
Grand Partage
Catégorisations et oppositions dualistes et artistotéliciennes, entre « Nature » et « Culture », mais aussi entre « Sacré » et « profane », « Sujet » et « objet », « masculin » et « féminin », « humain » et « non-humain ».
Holisme
Vision de la réalité, ou d’un phénomène particulier, comme étant un ensemble indivisible, ne pouvant pas être expliqué par ses différentes composantes considérées séparément. L’ensemble étant supérieur à la somme des parties.
Holocène
Ère géologique pré-capitalocène.
Holocentrisme
Approche holiste et constructiviste (BAWDEN, 2006) centré sur la diversité des systèmes de connaissance et d’action.
Malthusianisme
Doctrine de Malthus, qui considère la croissance démographique comme un danger, car non proportionnelle à la croissance des substances alimentaires.
ɴon-ᴀ
Pour non-aristotélicien. Une notion inspirée de la Sémantique Générale (KORZYBSKI, 1933). En résumé : « Une carte n’est pas le territoire » (ibid.). Les représentations mobilisées par les humain·e·s pour penser le monde ne sont pas le monde.
Obsujet
Ni objet ni sujet. Une « chose » dépassant la dichotomie objet/sujet.
Ontologie
Dans l’introduction est le développement : « des théories que des groupes humains ont élaborées afin de définir le réel, le déploiement du monde ainsi que les relations et les enchevêtrements entre l’humain·e et le non-humain, soit-il animal, végétal, minéral, ancestral, divin ou autre » (POIRIER 2016) ; voir les travaux de Philippe Descola sur l’écologie des relations dans “Par-delà nature et culture” » (DESCOLA, 2005).
Politique Agricole Commune
La PAC de l’Union Européenne, créatrice de malheurs durables. Les agricult·eur·rice·s européen·ne·s en agriculture conventionnelle, ne survivent que grâce aux « primes PAC » qui sont allouées à l’hectare. Ainsi l’entraide et le tissu social rural se voient remplacés par l’individualisme et la compétition, car les agricult·eur·rice·s adoptent des stratégies expansionnistes pour avoir toujours plus de terre et donc de primes. Sur ces surfaces agricoles disproportionnées l’agriculture industrielle devient le seul modèle possible.
Pænser
Penser tout en pensant. Combiner le soin à la réflexion. Inspiré des travaux du philosophe Bernard Stiegler (STIEGLER, 2018). Précisions qu’il est crucial de prendre en compte les causes de maux, et pas seulement panser les conséquences.
Paradigme
« Un paradigme est une représentation du monde, une manière de voir les choses, un modèle cohérent du monde qui repose sur un fondement défini ».
https://fr.wikipedia.org/wiki/Paradigme
Positivisme
La science comme description objective de la réalité.
Préservationnisme
Protéger la nature sans l’humain·e. Ségrégation humain·e·s/Nature.
Récit spéculatif
Type de narration permettant de déployer des nouveaux mondes en proposant des chemins du possible.
Réductionnisme
Vision de la réalité, ou d’un phénomène particulier, découpée et expliquée par ses différentes composantes considérées séparément.
Réseau trophique
« Un réseau trophique est un ensemble de chaînes alimentaires reliées entre elles au sein d’un écosystème et par lesquelles l’énergie et la biomasse circulent ».
https://fr.wikipedia.org/wiki/Réseau_trophique
Posthumanisme
Dépassement des idéaux hérités de l’Humanisme des Lumières (le « Progrès » basé sur la technique ; le « Savoir » objectif ; l’« Homme » et l’anthropocentrisme naturaliste) et de l’universalisation de la figure de l’homme hétérosexuel européen. À ne pas confondre avec le « posthumanisme » résultant du « transhumanisme ».
Postspécisme
Perspective qui dépasse le rapport mangeur-mangé (ou spéciste) dans la considération d’une égalité-animale entre humain et non-humain-animal.
Utilitarisme
Doctrine qui fait de l’utile, de ce qui sert à la vie ou au bonheur, le principe de toutes les valeurs dans le domaine de la connaissance comme dans celui de l’action » (CNRTL, 2021b), sans considération des valeurs intrinsèques des choses.
Zoocentrisme
Les anima·ux·les comme centre du monde.
Voir le Lexique digestif pages 61 et suivantes pour chaque astérisque. ↩︎
Le féminin pluriel « animales » est rare, mais ne voulant pas utiliser le masculin pluriel « animaux » comme une notion épicène, une version avec des points médians est ici mobilisée. ↩︎
Ailton Krenak, Idées pour retarder la fin du monde, 2020 ↩︎ ↩︎ ↩︎
La question de l’antispécisme et du véganisme dans les cultures non-industrielles, en particulier chez les pasteurs nomades, ne devrait pas se poser. La majorité de ces sociétés ne peuvent se passer de l’élevage et/ou de l’association polyculture-élevage pour subvenir à leurs besoins primaires. ↩︎
Les organismes pluricellulaires sont des écosystèmes composés d’innombrables autres organismes en interaction, parfois composés eux même d’autres organismes imbriqués dans des systèmes de poupées russes endosymbiotiques complexes. ↩︎
« Notre » corps serait composé d’autant de bactéries que de cellules humaines (SENDER, 2016). ↩︎
Un postspécisme ɴon-ᴀ (non-aristotélicien) met en exergue la nécessité du dépassement de l’aspect positiviste* de l’écocentrisme de l’écologie scientifique. Cette approche holocentrée* (BAWDEN, 2006) s’intègre dans la vision du « post- » ouvert à la multiplicité des chemins des possibles. L’approche holistique des propos ici développés semble être posée comme une réalité objective, mais nous la proposons non pas comme une description objective d’un « territoire » mais comme une « carte » pour des changements de paradigmes. ↩︎
Voir le concept de « Florestania » comme « citoyenneté forestière » (KRENAK, 2020), torloni_amazonia_2019} ; Ou l’original « TRAITÉ » entre humain et non-humain du laboratoire sauvage Désorceler La Finance (DLF, 2019). ↩︎
Grâce à l’énergie rayonnante du soleil et via la photosynthèse, les végétaux synthétisent des biomolécules en transformant des matières inorganiques. Cette énergie solaire est transformée en glucide, et alimente le reste des niveaux trophiques. ↩︎
Voir les travaux de la philosophe et militante écoféministe Val Plumwood, traduit en français dans « Dans la peau d’une proie – Renouer avec la vulnérabilité » (PLUMWOOD, 2020). ↩︎
Baptiste MORIZOT. 2016. Un seul ours debout. Dans la revue Ours, 2016. ↩︎
Christine Durif-Bruckert, « On devient ce que l’on mange » : Les enjeux identitaires de l’incorporation, 2017 ↩︎
La « zoophagie » est le fait de consommer des animaux, alors que la « sarcophagie » est le fait de manger l’objet « viande » en le dissociant de sa provenance vivante (VIALLES, 1988). La sarcophagie est entraînée par la distance de plus en plus grande entre le consommateur et l’éleveur. Elle est une profonde réification de la viande et des anima·ux·les non-humain·e·s. ↩︎
Mondher Kilani, Le cannibalisme. Une catégorie bonne à penser, 2006 ↩︎
Claude-Marie Dupin, « Les rituels : Enrichissement de la vie », 2009 ↩︎
Antonin Artaud, « Héliogabale ou l’Anarchiste couronné », 1934 ↩︎
VIE-MORT-VIE en grec. Extrait d’un énigmatique graffiti sur plaque d’os retrouvée à Olbia sur les rives de la mer Noire. Ces mots sont précédés de « Dionysos Orphikoi » (VERNANT, 1990). ↩︎
Clarissa Pinkola Estés, Femmes qui courent avec les loups : histoires et mythes de l’archétype de la femme sauvage, 2001. ISBN: 978-2-253-14785-5 ↩︎
La spiritualité étant : « Qualité de ce qui est esprit ou âme, concerne sa vie, ses manifestations ou qui est du domaine des valeurs morales » (https://www.cnrtl.fr/definition/spiritualité). La magie étant ici mobilisée comme une ontologie où la qualité de ce qui est esprit ou âme n’est pas propre aux humain·e·s, elle est donc considérée comme obligatoirement spirituelle. Les spiritualités ne sont par contre pas obligatoirement du ressort de la magie, pouvant aussi être religieuses et/ou philosophique. ↩︎
Comme l’illustre les adages attribués à Albert Einstein : « Un problème créé ne peut être résolu en réfléchissant de la même manière qu’il a été créé » ; « Le monde que nous avons créé est le résultat de notre niveau de réflexion, mais les problèmes qu’il engendre ne sauraient être résolus à ce même niveau. » ↩︎
Mais aussi : Renforcer les exécutant·e·s et leurs allié·e·s ; Diminuer les ennemi·e·s ; Créer des égrégores ; Et créer les contre-sorts au capitalisme. ↩︎
« Une des raisons pour lesquelles la mort est si éouvantable dans la tradition occidentale (…) est qu’elle suppose le méange interdit de catéories totalement séarés, la dissolution de l’humain-sacrédans le naturel-profane » (PLUMWOOD, 2020) ↩︎
Discours de Pierre-Gaspard Chaumette prononcé le 14 octobre 1793 ↩︎
Une religion qui ne serait pas vectrice d’un dualisme sacré/profane, mais une religion « moniste » de fusion avec « Gaïa ». Notons que la dichotomie sacré/profane comme éléments de définition des religions est une dérives scientifiques, et qu’elle est absente de certaines religions comme l’hindouisme (COUTURE, 2019). Les occidentaux en proie à des délires lors de leurs visites en Inde, s’abandonne justement à un « sentiment océanique », qui est une fusion dans le Grand Tout. ↩︎
